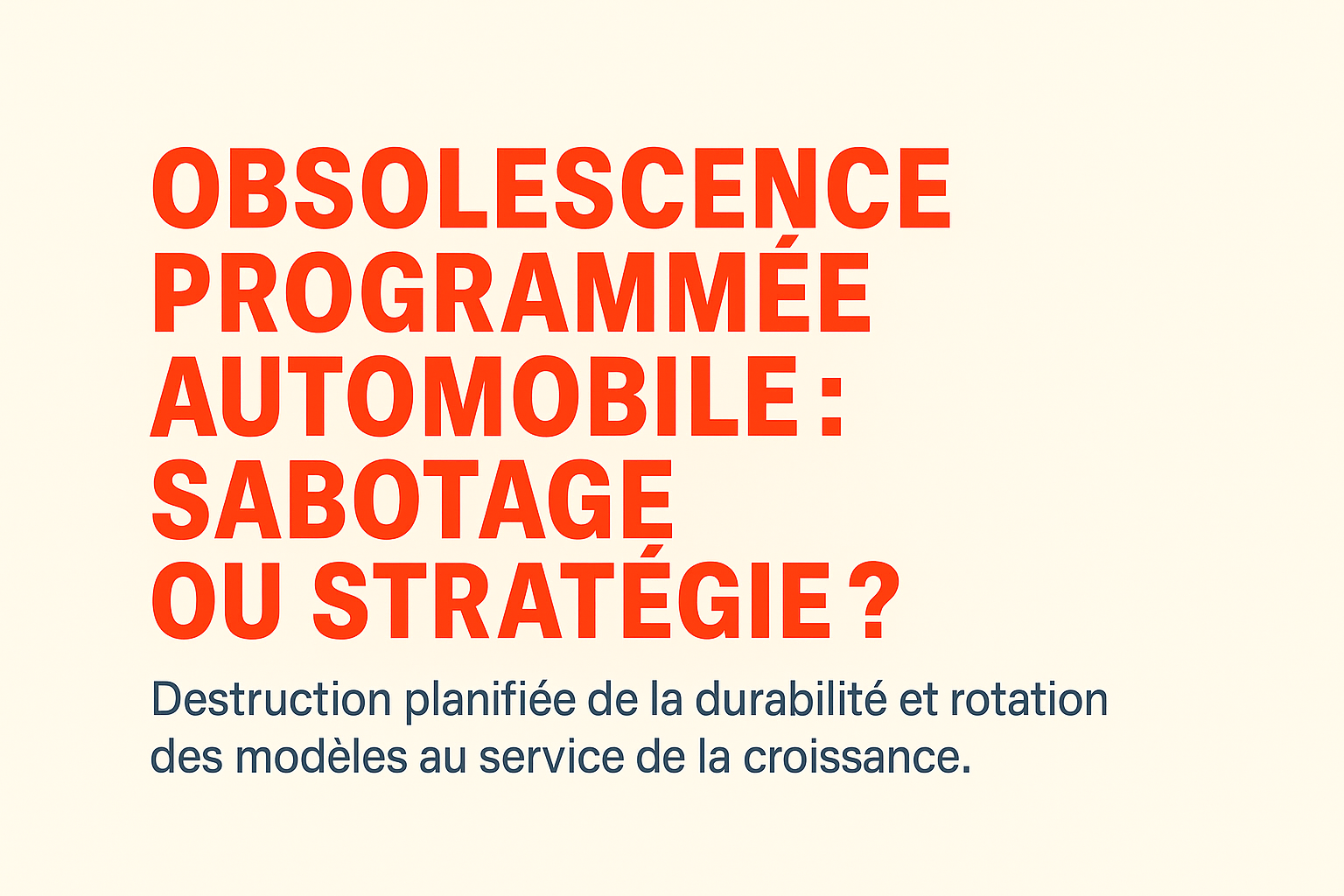La fin de la démarche esthétique des Français en faveur des objets durables
Il fut un temps, pas si lointain, où même les foyers les plus modestes en France vivaient avec une
démarche esthétique. Il ne s’agissait pas de luxe ou d’opulence, mais d’une volonté de beauté dans les gestes simples du quotidien : une table bien dressée, une tenue soignée, un intérieur harmonieux. C’était une culture partagée, qui transcendait les classes sociales. Aujourd’hui, cette démarche semble s’être effacée, engloutie par la consommation de masse, la vitesse et l’indifférence au beau. Les objets sont jetables, les espaces laids, les vêtements vulgaires…
Que s’est-il passé ? Comment renouer avec ce goût à la française si singulier ? Quels impacts sur l’écologie ?Une culture populaire où le beau avait du sens
Jusqu’au milieu du XXᵉ siècle, le beau n’était pas réservé à une élite. La France populaire cultivait une
esthétique de la dignité : un respect de soi, des autres, de l’environnement. L’historienne Michelle Perrot l’évoque dans ses travaux sur la vie domestique : la maison ouvrière était entretenue avec soin, les objets étaient réparés, transmis, embellis. Même les habits du dimanche portaient la marque d’une volonté de présentation, de mise en beauté de soi. C’était une démarche esthétique intégrée à la vie :
discrète, quotidienne, mais structurante. Elle exprimait un rapport au monde où l’on cherchait à faire durer, à transmettre, à embellir.
Le grand basculement : du goût au jetable
Tout change à partir des années 1950-1970, avec l’avènement de la société de consommation. L’industrialisation de masse, la mixité sociale, l’urbanisme sans visage, la publicité omniprésente et la télévision uniformisent les goûts, accélèrent le rythme et déplacent les repères.
L’objet devient un produit. L’usage cède la place à la mode. L’ornement disparaît Jean Baudrillard, dans
Le Système des objets (1968), décrivait déjà cette mutation : nous passons d’une
société d’usage à une
société de signe, où l’on achète pour “paraître” plutôt que pour “être”. Aujourd’hui, cette logique atteint son paroxysme. Les plateformes comme Temu ou Shein illustrent l’effondrement de toute démarche esthétique. Elles diffusent à grande échelle des produits à bas coût, fabriqués dans des conditions opaques, sans qualité, sans style, ni respect de l’environnement. Ces objets sont conçus pour être consommés vite, oubliés vite, jetés vite. Ce phénomène alimente une
production massive de déchets, une perte totale du goût et un
appauvrissement culturel profond.
En détruisant le lien entre objet et sens, entre vêtement et personne, entre intérieur et soin, on détruit aussi un rapport au monde basé sur
l’attention, la durée, la beauté.L’esthétique comme levier de durabilité
Contrairement à ce que l’on croit,
la beauté n’est pas un luxe. C’est un
levier puissant de durabilité. Une étude du MIT (2017) a démontré que lorsqu’un objet est perçu comme esthétiquement plaisant et porteur de sens, il est
conservé 30 à 50 % plus longtemps.
Ce lien émotionnel avec le beau augmente la réparation, diminue le gaspillage et crée une relation responsable avec les choses. Adopter une démarche esthétique n’est donc pas une coquetterie : c’est un
acte de résistance face à l’obsolescence programmée et à l’uniformisation. C’est une
écologie culturelle, autant qu’un choix de vie.
Le beau comme engagement
Revaloriser la démarche esthétique, c’est
se reconnecter à soi, aux autres, au monde. C’est faire du soin, de la tenue, de la beauté
une forme d’engagement — culturel, écologique, politique. Le vrai luxe, ce n’est pas d’avoir.
C’est choisir des
objets durables, qui ont du sens, et qui élèvent. Lisez aussi les articles
la consommation positive ou aussi
Fuyez le design futuriste